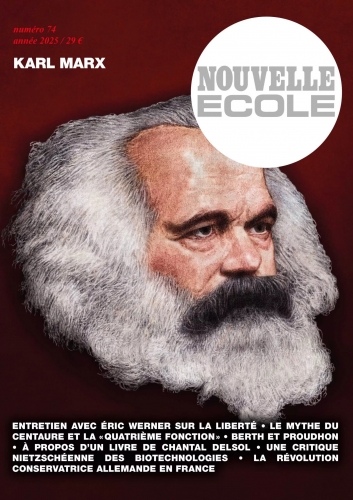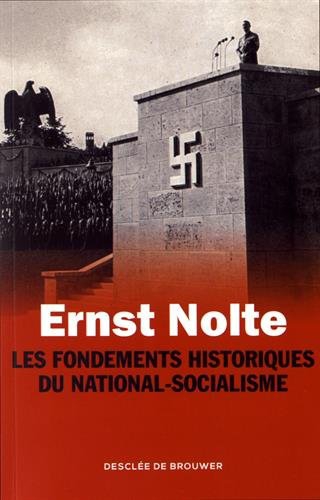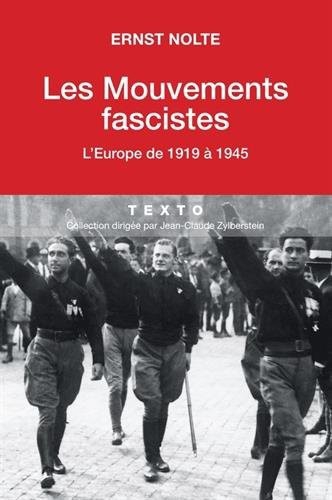La Deuxième Guerre mondiale est-elle vraiment terminée ?
Libres réflexions sur le début et la fin du dernier conflit mondial
« La deuxième Guerre mondiale a commencé le 1er septembre 1939 avec l’invasion de la Pologne par les troupes nazies et s’est terminée le 8 mai 1945 avec la capitulation du Reich. » C’est ce qu’on apprenait dans les manuels scolaires des années 1950-1960 dans les écoles suisses et françaises. Pendant cinquante ans, ces dates me semblaient coulées dans le bronze et il ne me serait pas venu à l’idée qu’on puisse les remettre en cause.
Cependant, le Japon ayant été vaincu par les Etats-Unis après avoir reçu deux bombes atomiques, il a été assez vite admis qu’il fallait repousser la date de la fin de la deuxième Guerre mondiale au 2 septembre 1945, jour de la capitulation du Japon. Mais en Europe occidentale, cette date du 2 septembre est restée très abstraite. En effet, comme à cette époque on avait l’habitude de commémorer les dates du 11 novembre 1918, fin de la Première Guerre mondiale, et du 8 mai 1945, fin de la deuxième, c’est cette dernière date qui est restée gravée dans ma mémoire personnelle et dans la mémoire collective de la majorité des Européens occidentaux.
Il a fallu attendre 1991, la dissolution de l’Union soviétique et le « retour » des pays est-européens dans le giron occidental pour découvrir qu’à l’est, et en Russie notamment, on célébrait la fin de la Victoire sur le Reich le 9 mai et non le 8, à cause du décalage horaire provoqué par la signature tard dans la nuit de l’armistice. Du coup, les célébrations de la victoire sur le fascisme intervenaient un jour plus tôt en Occident. Ce qui lui permettait de s’attribuer, en catimini, la totalité de l’honneur de la victoire, devant la Russie soviétique qui se trouvait condamnée à ne la célébrer que le lendemain, comme un comparse de deuxième rang, un allié de deuxième zone, alors même qu’elle avait été le principal artisan de la victoire !
Cet effacement progressif de la contribution russo-soviétique à la victoire sur le nazisme a été puissamment renforcé par la montée en puissance de la date du 6 juin 1944, jour du Débarquement de Normandie, dont la commémoration a pris une importance de plus en plus marquée à la fin de la Guerre froide et après la disparition de l’Union soviétique. Il s’agissait pour les Occidentaux, de consolider l’Alliance atlantique, de renforcer le front « démocratique » contre le communisme et de réintégrer l’Allemagne dans le concert des nations européennes aussi bien au sein de l’Union européenne que de l’OTAN.
La célébration du Débarquement avait donc l’immense avantage de permettre de mettre de côté la Russie, sous prétexte qu’elle n’était pas présente sur les plages de Normandie le 6 juin, et d’adopter la posture du vainqueur magnanime en invitant les vaincus, les Allemands, aux cérémonies. C’est ainsi que le 6 juin 2019, à l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement, les « Alliés » ont invité Angela Merkel en Normandie mais pas Vladimir Poutine, dont le pays avait pourtant libéré l’Europe du nazisme au prix de 26 millions de morts ! Au diable les réalités de l’Histoire, quand on peut ajouter l’injure à la distorsion des faits…
Naturellement cette forfaiture n’aurait jamais été possible du vivant des survivants du Débarquement. Les soldats alliés qui ont débarqué en Normandie, qu’ils aient été Anglais, Américains, Français ou Canadiens, savaient parfaitement qu’ils devaient leur vie et leur succès au sacrifice de dizaines de milliers de soldats soviétiques qui, pendant ces jours fatidiques, se faisaient tuer au combat sur le front de l’est pour empêcher Hitler de rapatrier ses blindés et ses troupes de choc en Normandie afin de faire échec au débarquement. Ils auraient été indignés que, pour des raisons politiques, la Russie fût exclue des festivités. Leurs témoignages sont très clairs à ce sujet. Mais aujourd’hui, les derniers survivants disparaissent, et avec eux l’esprit de justice et de fraternité des armes qu’ils défendaient.
Il serait intéressant de faire un sondage d’opinion. Mais je suis convaincu qu’aujourd’hui, en Europe occidentale, la date du 6 juin 1944 concurrence et même précède celle du 8 mai 1945 comme date essentielle de la deuxième Guerre mondiale. Elle devance en tout cas largement la date de la bataille de Stalingrad dans la mémoire collective ouest-européenne, qui pense par ailleurs que ce sont les Etats-Unis qui ont permis de vaincre l’Allemagne nazie.
Cela étant dit, la question des dates du début et de la fin de la 2e GM dépasse de loin ces considérations. On sait que pour les Chinois par exemple, la deuxième Guerre mondiale a commencé en 1937 déjà, avec l’invasion de la Chine orientale par les troupes japonaises, voire en 1931 si l’on remonte à l’occupation de la Mandchourie. Cette date n’est pourtant jamais retenue alors que la Chine, avec un bilan estimé entre 10 et 20 millions de morts, a payé le plus lourd tribut de la guerre après l’Union soviétique (Allemagne 7-9 millions, USA 0.4 million, Japon 2.5-3 millions).
Inversement, dans d’autres pays comme la Russie et les Etats-Unis, la Deuxième Guerre mondiale ne commence que le 22 juin 1941 avec l’Opération Barbarossa et le début de la Grande Guerre Patriotique (au risque d’oublier l’occupation de la Pologne orientale et la guerre de Finlande en automne 1939) et le 7 décembre 1941 avec l’attaque de Pearl Harbour.
On ne saurait pourtant réduire une guerre à ses seules batailles et opérations militaires. Si l’on pense avec Clausewitz que la guerre n’est que la poursuite de la politique par d’autres moyens, alors il faut aussi considérer les événements politiques. Et là, les choses se compliquent beaucoup. Les dates deviennent de moins en moins pertinentes, le choix dépendant fortement de l’idéologie et de l’origine géographique des auteurs.
Certains auteurs antisoviétiques ou antirusses ont par exemple suggéré de faire démarrer les hostilités avec le Pacte Molotov-Ribbentrop du 23 août 1939, oubliant commodément les accords de Munich du 30 septembre 1938. Ce sont pourtant ces derniers accords qui avaient abouti à l’invasion des Sudètes en Tchécoslovaquie et qui, de façon discrète et pernicieuse, avaient aussi cherché à détourner les appétits de conquête de Hitler vers l’Union soviétique plutôt que vers la France et la Grande-Bretagne. Cet aspect des accords de Munich n’est jamais mentionné par les historiens occidentaux alors même qu’il a conforté le bellicisme de l’Allemagne nazie. Après Munich, Hitler n’avait plus à se demander s’il voulait attaquer d’abord à l’est ou d’abord à l’ouest. Ce serait l’est, ce que Staline avait parfaitement compris et l’amena à conclure le pacte Molotov-Ribbentrop.
Quoiqu’il en soit, la majorité des historiens s’accorde à penser que la principale cause de la Deuxième Guerre mondiale résulte du « Diktat » de Versailles, qui a imposé en 1921 des conditions excessivement dures à l’Allemagne et amplifié les frustrations qui ont encouragé le revanchisme nazi après la crise financière de 1923 et la crise économique de 1929.
Soit. Mais si l’on remonte au traité de paix de 1921, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Une vision un peu plus large, ou plus distanciée, du 2e conflit mondial devrait remonter non pas à la conclusion provisoire de la Première Guerre mondiale mais à son déroulement. C’est ce que suggère la thèse de l’historien révisionniste allemand Ernst Nolte, pour qui la Deuxième Guerre mondiale n’est qu’une grande guerre civile commencée en 1917, lorsque la Première Guerre mondiale eut pour funeste conséquence de conduire à la révolution bolchévique. Pour Nolte, la Deuxième Guerre mondiale commence donc en Russie en 1917 pour s’achever en 1945. C’est en tout cas ce que reflète le titre de son ouvrage majeur « La Guerre civile européenne, 1917-1945 », dans lequel il défend l’idée que le nazisme s’est développé en réaction au communisme et au « judéo-bolchévisme ». Cette thèse contestable a provoqué dans les années 1980 ce qu’on a appelé la « querelle des historiens ». Les critiques de Nolte l’ont accusé, à juste titre, de relativiser la responsabilité des crimes nazis en les faisant remonter au communisme et en donnant du crédit aux comparaisons du style Staline égale Hitler (ou Hitler égale Staline), très en vogue aujourd’hui dans les cercles dirigeants occidentaux.
Cette reconstruction a posteriori des enchainements chronologiques de la Deuxième Guerre mondiale et cette manière d’établir des équivalences sont évidemment très discutables. Si l’on postule que la Révolution bolchévique a engendré le communisme, et par là le nazisme, il faut alors s’interroger sur les causes et la nature de cette révolution. Et surtout il faut alors remonter au moins jusqu’en 1914 et à l’éclatement de la Première Guerre mondiale, laquelle n’a d’ailleurs pas seulement entrainé la chute du tsarisme mais aussi celle des régimes monarchiques allemand et autrichien.
Mais cela n’est pas notre but ici. Si l’on élargit la perspective de Nolte en abandonnant tout biais idéologique, on peut accepter son idée de guerre civile européenne. Une guerre civile qui aurait commencé en 1914, se serait terminée en 1945 et qui se serait soldée par la ruine de la civilisation européenne. Une guerre de trente ans, comme celle qui a divisé l’Europe entre 1618 et 1648, mais avec des résultats beaucoup catastrophiques sur le long terme. Ou plutôt une guerre civile de trente ans comme la Guerre du Péloponnèse qui, entre 431 et 404 avant JC, a ruiné la Grèce antique au point de la faire sortir de l’Histoire.
Comparaison n’est pas raison, surtout en histoire. Mais l’analogie entre les deux guerres mondiales et la guerre du Péloponnèse ouvre des pistes de réflexion intéressantes. Elle n’avait d’ailleurs pas échappé aux intellectuels de l’époque qui, comme Albert Thibaudet (La Campagne avec Thucydide, 1922), avaient été frappés par cette forme de suicide de la civilisation européenne qu’avait représenté la Première Guerre mondiale. Si cela a été vrai pour la Première, ça doit l’être a fortiori pour la Deuxième !
Ces deux guerres civiles sont proches par leur durée, mais aussi par la géographie (deux archipels formés de petits Etats à la fois maritimes et terrestres et dotés d’un rayonnement commercial, culturel, économique et militaire remarquable), par leur nature (une guerre civile qui coupe le monde civilisé en deux alliances de force quasi égale) et par leur résultat (un des deux camps obtient la victoire mais celle-ci affaiblit aussi bien les vainqueurs que les vaincus et profite dans les faits à des puissances périphériques (Macédoine et Rome après la Guerre du Péloponnèse, Union soviétique et Etats-Unis après la Grande Guerre civile européenne).
Nul ne peut contester qu’après la guerre du Péloponnèse, le foyer de la civilisation classique grecque qu’avaient représenté Athènes et Sparte s’est peu à peu étiolé, au profit de la Macédoine d’abord et de Rome ensuite. Voisine de la Grèce mais jugée non-grecque par beaucoup de Grecs, la Macédoine a tiré profit du conflit et, avec Alexandre le Grand, a même connu une brillante heure de gloire avant de s’effacer elle aussi devant la nouvelle puissance conquérante : Rome.
Comment ne pas faire le rapprochement avec l’Union soviétique, qui connut aussi son heure de gloire dans les années 1960 avant de s’effacer devant les Etats-Unis ? Etats-Unis qui, comme Rome après la guerre du Péloponnèse, intervinrent dans les affaires européennes à la faveur des conflits internes (une première fois en 1917, une deuxième en 1941 et une troisième en 1947 avec la Guerre froide) et finirent par ne plus jamais quitter le sol européen. A l’imitation des Romains qui, profitant de l’affaiblissement et des divisions internes grecques intervinrent une première fois en 212, une deuxième fois en 180 puis une troisième fois en 146 avant JC, cette fois-ci pour y rester définitivement en réduisant la Grèce à l’état de colonie romaine.
Arrêtons ici les analogies pour simplement suggérer que, si la date du début de la Deuxième Guerre mondiale peut beaucoup varier selon le point de vue des historiens, sa date de fin peut également être discutée. Certes, les armes se sont tues en 1945 sur le sol européen. Mais était-ce vraiment la fin du conflit ? La Guerre froide, pour retourner l’argument de Clausewitz, n’a-t-elle pas été la poursuite de la guerre chaude par d’autres moyens, moins meurtriers mais tout aussi efficaces ? Et les guerres de décolonisation, la guerre du Vietnam, et même le démembrement de la Yougoslavie et le bombardement de la Serbie, n’ont-ils pas été les ultimes batailles, éclatées et sporadiques, de la Deuxième Guerre mondiale ?
Et comment être sûr que cette Guerre soit vraiment terminée ? La victoire revendiquée par les Etats-Unis en 1991, après la disparition de l’adversaire soviétique, a-t-elle clos le débat ? Pas si sûr. Car entretemps, un autre protagoniste de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale a brusquement ressurgi sur la scène internationale, la Chine, avec une montée en puissance si rapide et si spectaculaire qu’elle ébranle les certitudes du vainqueur autoproclamé, qui craint désormais d’être surclassé.
On conclura donc provisoirement que la Deuxième Guerre mondiale s’est bien déroulée entre 1939 et 1945 mais que tant ses causes que ses conséquences sont loin d’avoir épuisé la réflexion. C’est le mérite des historiens de garder l’esprit ouvert et, à la lumière des faits, de soumettre à la critique et à la discussion des interprétations qui renouvellent le regard que l’on peut porter sur ce tragique événement.
Guy Mettan (Planète bleue, 22 juillet 2021)